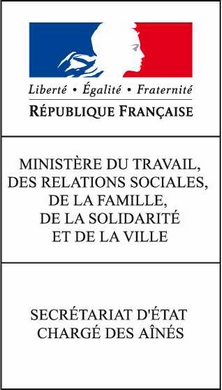
Jeudi 15 octobre 2009 – Maison de la Chimie : Discours de Madame Nora BERRA, "maintenir et restaurer l’autonomie"
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Mesdames et Messieurs les Directeurs, Professeurs et experts,
Je suis heureuse de me trouver parmi vous pour la clôture de vos travaux de cette matinée.
Ces troisièmes rencontres parlementaires sur la dépendance et le grand âge sont une initiative qui reflète la prise en considération de nos aînés dans notre pays. Je me réjouis que celle-ci soit une contribution de fond à la réflexion qui s’approfondit et se construit peu à peu au sujet du grand âge.
Je vous remercie de votre engagement et de votre participation à ce débat. Je remercie particulièrement les Députés Bérengère POLETTI, Denis JACQUAT et Danièle HOFFMAN qui président deux groupes d’étude à l’Assemblée Nationale, l’un sur la dépendance, l’autre sur la longévité, et qui, durant cette journée d’échange et de réflexion, ont présidé ces troisièmes rencontres parlementaires sur la dépendance.
La réflexion et l’action de mon Secrétariat d’Etat chargé des aînés sont indissociables de celles des parlementaires et de tous les acteurs qui se consacrent à la problématique des personnes âgées. Elles s’appuient aussi sur de nombreux autres ministères.
L’allongement de la durée de la vie en France et dans le monde est une réalité. C’est pour moi l’un des plus formidables acquis de notre époque. Il marque sans doute un progrès de notre civilisation, et aussi un moment historique dans l’évolution de la société française.
Il y a cependant une ombre à cet acquis : c’est le spectre de l’accroissement de la dépendance des personnes âgées et de la maladie d’Alzheimer, dont souffrent 860 000 personnes aujourd’hui. Chaque année, 80 000 personnes supplémentaires dépassent effectivement les 80 ans. La génération des "baby-boomers", qui arrivent à l’âge de la retraite, se sent aussi concernée par les problèmes de perte d’autonomie et de dépendance, car elle sait qu’elle y sera peut-être confrontée d’ici 20 ou 30 ans. Et la solidarité familiale, l’impact de la maladie d’Alzheimer sur l’entourage immédiat font qu’un nombre grandissant de Français se sentent effectivement concernés par la dépendance. Toutes les conditions sont donc réunies pour qu’il y ait à ce sujet un large débat.
Les enjeux financiers, vous le savez, sont importants, car l’accroissement de la longévité nous impose de veiller à l’équilibre de notre système de protection sociale et à sa pérennité. Cela repose sur la double soutenabilité – pour la personne âgée, les finances publiques – du dispositif de prise en charge de la dépendance. Je ne veux pas esquiver le débat sur les moyens de financement à moyen et long terme, qui doivent relever à la fois de la solidarité (Etat et collectivités territoriales), de la mobilisation du patrimoine, et d’une logique de prévoyance.
Mais vos travaux de ce matin illustrent un débat positif sur le vieillissement et la prévention de la dépendance : je le salue parce qu’il contribue au changement nécessaire de l’image du vieillissement dans notre société.
Un des enjeux principaux consiste à favoriser le recensement, la mise en valeur et le soutien systématique des initiatives qui s’inventent sur le terrain et se développent partout sur le territoire.
La réponse à la dépendance de nos aînés doit être apportée par l’ensemble de nos concitoyens, notamment les acteurs professionnels et bénévoles qui sont porteurs d’initiatives : dans le domaine de la recherche, de la médecine, de l’accompagnement médico-psycho-social, de l’économie, des nouvelles technologies.
Il y a, tout d’abord, la réflexion que vous avez menée dans le cadre de la table-ronde numéro 1 : "Sommes-nous tous en risque de dépendance ? ", qui, à partir d’une approche analytique renvoie, d’une part, chacun à son for intérieur, dans sa propre perception de la dépendance, et d’autre part, à son impact sociologique, voire sociétal.
Il y a aussi à élaborer des stratégies pour augmenter l’espérance de vie sans incapacité. Vous l’avez traitée dans la deuxième table-ronde. Elle correspond à une priorité de mon secrétariat : le plan "Bien vieillir ", l’amélioration des consultations de prévention des personnes âgées de plus de 70 ans, et aussi le barrage à la dépendance et à la perte d’autonomie, que représente l’atout de l’intergénérationnel pour y parvenir.
Enfin, il y a cette question essentielle que vous avez abordée, dans la table-ronde numéro 3, sur ce moment de vie où surgit la dépendance, sans toutefois entraîner une perte complète d’autonomie. Il faut alors freiner la perte d’autonomie en développant tout un système de stratégies innovantes au domicile, dans les centres d’accueil.
Avant d’évoquer ces différents points, permettez-moi de revenir sur le thème général de votre réflexion :
Pour moi, maintenir et restaurer l’autonomie des personnes les plus âgées, c’est d’abord parler de liberté et de droit. Votre réflexion s’inscrit pleinement dans la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap et de dépendance.
Je reviens sur les termes mêmes de votre débat :
- " maintenir l’autonomie", c’est d’abord préserver une liberté fondamentale, celle de continuer le plus longtemps possible un vrai parcours de vie. Ceci s’applique à la grande majorité de nos aînés, puisque 90% des Français âgés de plus de 60 ans sont en bonne santé, et que 80% des personnes âgées de plus de 85 ans ne sont pas en situation de dépendance.
- "restaurer l’autonomie", c’est en revanche prendre acte du fait que, à certains moments de la vie, celle-ci n’est plus assurée. On doit alors déployer les efforts nécessaires pour la rétablir. Cela indique qu’il n’y a pas de frontière irréversible, nette, définitive entre autonomie et dépendance.
La fragilité est un moment long et non irréversible entre dépendance et autonomie.
Elle est un facteur clé pour prévenir la perte d’autonomie, car elle signifie des soins médicaux meilleurs, mais aussi un entourage renforcé autour de la personne âgée.
C’est autour de cette prise en compte de la fragilité que doit s’engager notre combat, pour maintenir le plus longtemps possible l’autonomie des personnes âgées, puis la restaurer lorsque celle-ci est menacée.
De ce point de vue, nous savons bien qu’il faudra demain faire plus et mieux et trouver des solutions innovantes pour assurer le financement à long terme de la dépendance. Il faudra pour cela organiser intelligemment le financement public, la prévoyance et la prise en compte du patrimoine sous certaines conditions.
Mais je voudrais aussi souligner les efforts accomplis depuis le début de cette décennie :
- il y avait moins de 300 000 bénéficiaires de la Prestation Spécifique Dépendance en 2001, il y a plus d’un million de bénéficiaires de l'APA aujourd’hui.
- le budget consacré par l'Assurance maladie aux établissements et services pour personnes âgées est passé de 2 milliards 300 millions. en 2000 à presque 8 milliards en 2010 : c’est 4 fois plus !
- Ce sont plus de 50 000 emplois soignants qui ont été créés dans les maisons de retraites et services de soins.
- le rythme de création de places en EHPAD a été porté de 2500 (2003) à 7500 (2008), et même à 12500 en 2009 !
Vous savez par ailleurs, Mesdames et Messieurs que les personnes âgées aspirent à rester le plus longtemps possible chez elles.
C’est le meilleur atout pour continuer à vivre librement, et pour retarder la dépendance. A ce sujet, le rapport du Centre d’analyse stratégique de 2006 "personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du libre-choix", mentionnait qu’entre 2010 et 2015, l’offre de places en établissement pourrait être suffisante si la politique d’aide à domicile compensait la croissance démographique des personnes dépendantes.
Depuis, cette hypothèse s’est avérée vraisemblable puisque la part des personnes lourdement dépendantes (GIR 1-2) vivant en institution est restée stable à 64%, tandis que celle des personnes moyennement dépendantes (GIR 3-4) est passée de 28% à 24%.
C’est pourquoi, comme vous le savez, le développement des services de soins infirmiers et de services d’aide à la personne à domicile, de garde de nuit et d’accueil de jour, contribue à maintenir le plus longtemps possible l’autonomie des personnes.
C’est pendant ce moment crucial de fragilité que doivent se renforcer les systèmes d’aide les mieux adaptés à la personne menacée par la perte d’autonomie.
La montée en puissance de ces services est génératrice d’emplois nouveaux.
Ensuite, il faut aussi évoluer vers des centres d’accueil qui ne soient pas des lieux de rupture avec l’extérieur, mais de continuité du parcours de vie.
C’est dans cet esprit que nous sommes en train de mettre en place les MAIA, ces maisons qui accueillent les malades d’Alzheimer, en permettant une véritable synergie entre les équipes de soins et les aidants familiaux, notamment grâce à la mise en place de coordonnateurs de cas complexes.
Il s’agit non seulement de mieux prendre en compte les personnes en perte d’autonomie, mais aussi les aidants familiaux, qui ne doivent pas devenir les deuxièmes victimes de l’Alzheimer.
Le plan Alzheimer prévoit aussi le développement de structures de répit pour les aidants familiaux : savez-vous que, pour les conjoints de malades d’Alzheimer, le taux de mortalité augmente de 50%, sous l’effet du fardeau physique et psychologique que cette maladie représente ? Traiter plus humainement et efficacement la dépendance du malade, c’est prévenir aussi le danger de perte d’autonomie plus rapide du conjoint.
Si le maintien à domicile est un élément positif pour préserver l’autonomie, n’oublions pas qu’il est aussi un facteur de risque, car il faut prévenir les chutes, les blessures, les dangers qui peuvent survenir dans la vie quotidienne.
L’inadaptation de l’habitat et des aménagements urbains constitue en effet une menace constante pour les personnes âgées. Il devient donc nécessaire de repenser la ville de manière globale, et d’assurer une fluidité entre les espaces qui structurent l’autonomie, la mobilité et la participation des aînés à la vie de la cité.
Dans cette dynamique, les aînés actifs jouent un rôle essentiel. Ils sont les experts de leur quotidien dans la ville, et ils peuvent, avec les associations, participer à l’élaboration des plans généraux d’accessibilité que les Maires sont en train de mettre en place dans leur commune.
Le programme "villes, amies des aînés" met en regard le constat du vieillissement croissant de la population et celui d’une urbanisation généralisée. C’est pourquoi j’ai lancé avec Roselyne BACHELOT en juillet 2009, le label "Bien vieillir ", avec l’Association des Maires de France et l’association parlementaire "Vivre ensemble". L’habitat des aînés peut se décliner en habitat intergénérationnel et en habitat partagé entre aînés.
L’enjeu à terme du maintien et de la restauration de l’autonomie, c’est donc celui de l’adaptation de la ville, des transports et des logements. C’est un enjeu d’adaptation, mais aussi d’anticipation, de localisation, de mobilité, en milieu rural comme en milieu urbain.
Cette lutte pour la préservation de l’autonomie sera facilitée par le fait qu’elle représente une opportunité économique, en termes d’emplois non-délocalisables, et répartis sur l’ensemble du territoire, et de développement des gérontotechnologies.
Préserver l’autonomie, c’est aussi limiter le coût des prises en charge à l’hôpital et en institution.
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de conclure ce propos en rappelant que tous les citoyens de ce pays possèdent les clefs du bien vieillir.
La première d’entre elles, c’est la force du lien intergénérationnel, qui resserre et rassemble les familles, le réseau associatif, les bénévoles.
Il y en a d’autres : celle de la recherche, qui représente un espoir immense, celle de l’économie, avec les gérontotechnologies qui peuvent demain, comme au Japon, contribuer à l’équilibre de notre balance commerciale.
Ce sont aussi les clefs d’une « Ville plus humaine », plus conviviale, plus accessible à tous, que nous sommes en train d’imaginer comme le lieu de prévention de la dépendance et du maintien social.
Je vous remercie d’avoir abordé ces sujets aujourd’hui. Car vous êtes enracinés dans la société. Car vos réflexions sont étayées par la compétence, l’expérience et les solutions qui s’inventent sur le terrain.
C’est toute une orientation de notre société à laquelle vous travaillez avec humanisme. Comptez sur moi pour mettre sur la table, aux côtés de Xavier DARCOS, toute la problématique qui va nous permettre, dans ce pays, de bâtir une société pour tous les âges !
Avec Capgeris.com, le portail des services pour les personnes âges et les seniors , leurs proches, les aidants et les professionnels des maisons de retraite, résidences seniors, habitats partagés et des services à la personne. Suivez l'actualité 100% seniors et personnes âgées, et restez informés âgées